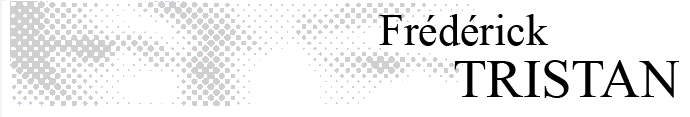Nom de Dieu
par Nicolas Givry
L’anagramme du vide, de Frédérick Tristan, se présente comme une grande salle dont l’auteur aurait un à un retiré les meubles pour parvenir, d’un ton faussement badin, à l’essentiel. Tant qu’à la fin on a envie de s’écrier avec Graciàn : «Oh ! que le vide est beaucoup !»
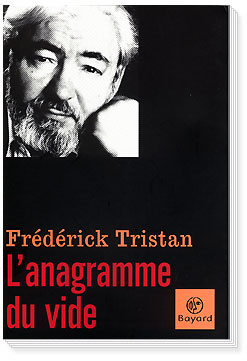
L’anagramme du vide, Frédérick Tristan, Bayard, col. Qui donc est Dieu ?, 96 p., 13,90 €
Il y a d’abord ce titre, qui mêle cabale phonétique et taoïsme : L’anagramme du vide —c’est-à-dire “Dieu”. Un sacré titre si l’on ose dire ! Voilà qui relève l’intérêt pour un ouvrage que l’on devine être de commande. Mais ne boudons pas notre plaisir ! Frédérick Tristan nous invite à un érudit et éblouissant « bavardage », tout en digressions sur ce mot “Dieu” apposé comme un masque sur l’Inconnaissable. Idolâtres et bigots de tous poils, passez votre chemin ! Nous sommes ici en savante — et spirituelle — compagnie. L’auteur, qui avoue d’emblée que le mot « Dieu » lui est suspect comme celui de « croire » a placé en exergue de son livre le beau cri de Maître Eckhart : « Je prie Dieu qu’il me libère de Dieu ». Il s’agit bien d’une invitation à se défaire de ce que Frédérick Tristan appelle « le Dieu désignable », qui ne tarde jamais trop à s’enfermer dans un concept. « Or, écrit l’auteur, c’est au moment où il dépassera et annulera ce leurre que l’esprit d’ouverture pourra accéder à ce que ce concept dissimule ». Et d’enfoncer le clou : « Des mots comme « théisme », « déisme », « athéisme », « monothéisme », « polythéisme » appartiennent à un vocabulaire qui ne recouvre plus de solides notions. (…) À l’abri pluvieux de tels mots dévalués, comment les hommes d’aujourd’hui pourraient-ils échapper à un inconfortable conformisme ou à une errance angoissée ? »
De l’idole à “Cela” ou la découverte de “l’Innommé”
Mais comment l’intuition spirituelle peut-elle aujourd’hui s’affranchir de toutes les digues, sociales, morales ou religieuses qui font barrage aux étages supérieurs de la conscience ? Comment redonner tout son sens à l’imagination créatrice, cette clef d’accès à ce qu’Henry Corbin nommait le « monde imaginal » ? Car l’homme moderne qui accepte sans ciller la stratification de la conscience proposée par la psychologie des profondeurs a depuis loin rejeté toute perception du monde spirituel dans une sous-catégorie de la science-fiction… Et pourtant, de Denys l’Aréopagite à Lao Tzi, les références ne manquent pas pour, comme le dit Tristan, « dépasser l’idole, atteindre l’icône puis le sans forme qui est Cela ». Une ultime présence qui n’est alors discernable que par le poids incommensurable de son absence : L’anagramme du vide. « C’est en se penchant sur ce vide qu’il devient possible de percevoir la réalité enfin ouverte à l’esprit éveillé, brisant la roue et la rouerie du réel travesti ». Et l’auteur ne tarde pas à en venir au point nodal de sa réflexion : « Le Dieu nommé est un masque de nous-même. À travers l’adoration que nous lui portons, c’est nous même que nous adorons (…) Quand à l’Innommé, n’étant rien de ce que nous pouvons seulement supposer, nul n’aurait l’idée de le personnaliser et de l’adorer. (…) Pourquoi ? Parce que le chercheur est cherché. (…) Parce que le Cela est glissé dans l’interstice de toute quête ».
L’anagramme du vide se présente ainsi comme une grande salle dont l’auteur aurait un à un retiré les meubles pour parvenir, d’un ton faussement badin, à l’essentiel. Tant qu’à la fin on a envie de s’écrier avec Graciàn : «Oh ! que le vide est beaucoup !»
Jan Demeulenaere
« Une réflexion hermétique
sur le thème du passage vers l’au-delà… »
Psychologue de formation, passionné par la transmission d’anciens « métiers » (forge, reliure, tapisserie…) dont il a acquis les techniques, Jan Demeulenaere est aussi le fondateur d’une petite maison d’édition, Le Moulin de l’Étoile, consacrée à l’alchimie, au symbolisme et à l’hermétisme chrétien. Il publie aujourd’hui un ouvrage de Frédérick Tristan alliant poésie hermétique et recherche graphique, le Passage de l’Ombre — mis en page par le graphiste Joël Picton (1926-1993).
À quelle occasion avez-vous découvert le travail de Joël Picton ?
Jan Demeulenaere : J’ai la chance de connaître la femme de Joël Picton, Marie-Claire, depuis plusieurs années. Je ne m’étais pas intéressé au travail du graphiste jusqu’au jour où celle-ci me convia à une exposition retraçant l’œuvre de son mari à l’occasion du 10e anniversaire de sa disparition. Une grande part des travaux exposés concernait ce que l’on appelait alors le « livre inconnu ». Élève de Bissière, ami de Delteil, Bazin, Giono, Joël Picton avait côtoyé les plus grands comme graveur et imprimeur d’art. Il avait également fondé Recherches Graphiques et travaillé fréquemment avec le graveur et typographe Fernand Gautier rencontré à Narbonne en 1960. Quelques années plus tôt, le texte de Frédérick Tristan — écrit en 1952 — lui parut digne d’être mis en page et servit de trame à son expression créative. Ce travail fut, en de multiples occasions, remanié — sans toutefois parvenir à son terme. Ce sera la sortie de Miracle privé d’Hervé Bazin qui consacrera Recherches Graphiques en 1955, mais fera abandonner le projet de Passage de l’ombre jusqu’à sa reprise par Fernand Gautier en 1980. Les dernières années de sa vie seront consacrées au texte Les balayeurs de lunes, sorti en tirage limité en 1989 et devenu fort rare. Joël Picton prévoyait déjà la parution de Passage de l’ombre pour 1990 mais sa soif de perfection ne lui permit malheureusement pas d’aboutir avant d’être rattrapé par le temps.

La première planche de l’ouvrage. Un Incipit qui ouvre le Voyage vers l’invisible…
Vous avez été immédiatement fasciné par ces planches ?
Jan Demeulenaere : Absolument. Travaillant les mises en pages typographiques de Joël Picton sur des feuilles de grande taille, ces mots affichés durant l’exposition avaient un impact hors du commun. Frédérick Tristan m’apprit par la suite que Joël Picton travaillait effectivement par affichage, se plaisant à rappeler qu’ « une écriture n’est bonne que si elle tient au mur ». Cet effet saisissant fut chez moi renforcé par la simplicité et la beauté des aplats noirs qui oscillent entre Bahaüs et Constructivisme. Ce souvenir ne m’ayant jamais quitté, j’attendis d’avoir fait « mes armes » d’éditeur avant d’aller trouver Frédérick Tristan et Marie-Claire Picton pour leur proposer d’achever cette confrontation entre l’auteur et le graphiste débutée en 1952. Cette fascination sera encore renforcée lorsque j’ouvris la boîte de Pandore, carton plein d’essais relatifs au Passage de l’Ombre : planches couleurs, plaques offset, polices de caractères découpées et minutieusement collées… Mon attirance pour ce travail atteindra son paroxysme lors du choix des épreuves, du « nettoyage » informatique des pages et mon obstination à respecter scrupuleusement les choix de mise en page réfléchis par son réalisateur initial. Ce fut un plaisir immense que de réitérer l’expérience d’une exposition autour de Passage de l’ombre le 18 novembre dernier en présence de Frédérick Tristan. Treize ans jour pour jour après la mort du graphiste, le livre était là et ses planches reprenaient vie…
Comment peut-on présenter Passage de l’ombre ? Il ne s’agit pas à proprement parler d’une œuvre ésotérique…
Jan Demeulenaere : Si l’on considère les choix éditoriaux du Moulin de l’Étoile, chaque ouvrage est à considérer comme une clef de compréhension de l’invisible par le visible. Nous ne parlerons pas bien sûr d’ésotérisme à propos de Passage de l’ombre même si de nombreux éléments constituant l’ouvrage participent d’une réflexion que nous pourrions qualifier d’hermétique. Rigoureusement calculés, les mises en pages et les choix typographiques respectent des règles harmoniques particulièrement réfléchies, basées, entre autres, sur le Nombre d’Or. Rien n’est également laissé au hasard en ce qui concerne les planches dessinées : elles renvoient toutes à l’idée du passage vers l’au-delà, venant soutenir un poème en prose évoquant la guerre, le « pont sur la mort »… Frédérick Tristan considère à ce titre que Passage de l’ombre représente un condensé de l’œuvre graphique telle que Picton la souhaitait : « Une œuvre qui, à travers l’empreinte de la main, révèle une trace de l’invisible ».
Quel a été le rôle de Frédérick Tristan dans la réalisation de l’ouvrage ? On imagine que la mise en page n’est pas allée sans problèmes techniques ?
Jan Demeulenaere : Plus que des difficultés techniques — aujourd’hui aisément contournables — les choix de mise en page ont souvent donné lieu à des débats obsessionnels et passionnés avec l’auteur. S’il a été fastidieux pour moi de respecter les calculs de mise en page de Joël Picton ou de rafraîchir scrupuleusement certaines pages manuscrites, les vraies difficultés arrivaient lorsqu’il s’agissait de choisir entre trois voire quatre versions d’une même page. Il va sans dire que le rôle de Frédérick Tristan fut alors essentiel : il me semblait naturel qu’il décide in fine en cas d’hésitation ou de désaccord. Les annotations du graphiste auraient permis de remonter le texte en utilisant les polices indiquées, voire d’en faire un tirage couleur. L’auteur en décida autrement, souhaitant conserver l’écriture manuscrite de Joël Picton en mémoire de son ami et pour l’importance que celui-ci accordait au tracé de la main. Le noir des maquettes originales restait également une option cohérente compte tenu de la teneur du texte et de l’impact des planches monochromes. C’est, au final, une œuvre très proche des maquettes de 1954, fidèle à l’esprit de Recherches Graphiques, respectant jusqu’au choix du papier les souhaits de Joël Picton. C’est une grande satisfaction que de pouvoir proposer aujourd’hui cet « objet-livre » aux curieux, véritable témoin d’une époque et œuvre de jeunesse que je sais chère à son auteur. Faisant paraître Les balayeurs de lunes, 27 ans après sa première maquette, Joël Picton introduisait son livre par une phrase éloquente aujourd’hui plus que de circonstance : « Car tout à une fin, et je le prouve ! ».
Propos recueillis par
Nicolas Givry
 Passage de l’ombre 1952-1954, Frédérick Tristan, Joël Picton, 112 pages, 29 euros (ou 44 euros pour le tirage de tête). Pour plus d’information : Le Moulin de l’Étoile, 37, Le Gros Chêne, 41160 Busloup – info@lemoulindeletoile.com
Passage de l’ombre 1952-1954, Frédérick Tristan, Joël Picton, 112 pages, 29 euros (ou 44 euros pour le tirage de tête). Pour plus d’information : Le Moulin de l’Étoile, 37, Le Gros Chêne, 41160 Busloup – info@lemoulindeletoile.com
Le lancement de Symbole avec Frédérick Tristan
Par CEAPT Symbole copyright, mardi 5 juin 2007 à 17:25 - Revue Symbole - #92 - rss
Pour fêter la parution de son premier numéro papier, l'équipe de Symbole a accueilli, le lundi 14 mai rue de Vaugirard à Paris, une centaine d'amis. Notre rédacteur en chef, Jean-Marie Beaume, présenta notre ardente aventure intellectuelle et spirituelle. Puis notre "parrain", Frédérick Tristan, anima la soirée par une conférence dont il a le secret sur "Fiction littéraire et réalités spirituelles" avant de dédicacer son récent roman Dernières nouvelles de l'au-delà (Fayard éd.). Le cocktail permit à chacun de rencontrer un certain nombre d'auteurs, tels Luc de Goustine, Philippe Barthelet, Xavier Accart... et de faire connaissance avec les responsables de Symbole. En écho à cette soirée, nous vous proposons l'intégralité de la conférence de Frédérick Tristan.

Frédérick Tristan : "En tant que romancier, je me sens plus artiste qu'intellectuel, et il se peut que ce soit ma part de talent." Photo : Louis Monier.
IMPORTANT ! :
Pour commander ce premier numéro en librairie, il est nécessaire de préciser la référence complète du titre de l'ouvrage ("La Nature et le sacré", Éd. Dervy).
***
Fiction romanesque et réalités spirituelles
par
Frédérick Tristan
Mes chers Amis,
Si vous le permettez, je vais commencer mon propos par une confession. Jamais, lors de mon travail d'écriture, je ne me suis posé la question du rapport entre la fiction littéraire et mon expérience intérieure. La raison en est simple. Les deux appartiennent à la matière même de mon existence, et cela depuis très longtemps. Plus qu'un intellectuel, je suis un artiste, ce qui peut s'entendre de diverses façons. J'avoue que j'aimerais, par humour, être comparé à un artiste au fourneau que vous l'entendiez en terme de gastronomie ou d'alchimie. En effet, je n'ai jamais conçu un récit que comme un réel enfantement, la part du père (entendez de l'esprit spermatique) étant certes nécessaire mais inférieur à celui de la mère (entendez de la conscience, voire de l'âme, le réceptacle à féconder.) Cette audacieuse comparaison, non exempte d'une vérité d'expérience, a du moins le mérite de remettre à sa place la part volontaire d'un écrivant tel que moi. Je suis, en effet, plus guidé par un onirisme éveillé et un somnambulisme actif que par une stratégie esthétique ou éthique.
Question, par exemple, que je ne me suis jamais vraiment posée : qu'est-ce qu'écrire ? Pourtant je sais bien que ma vie est un récit et qu'en écrivant j'en invente un autre. Aussi est-il préférable que cet autre soit une invention issue d'une réserve d'images, ou d'idées, ou de je ne sais quoi qui appartienne vraiment à quelque chose du vécu, à un degré ou à un autre- et cela peut aller du concret le plus réaliste à l'abstrait le plus débridé. Pourquoi ? Parce que l'art est une façon de transformer la réalité en une réalité seconde. Récit sur récit. Mise en abyme. Et puisqu'on ne peut faire autrement, exagérons donc cette évidence pour en faire une somme imaginaire qui alerte la tribu.
Encore faut-il que cet imaginaire troublant soit bien nourri. Vous savez que nous sommes faits des aliments que nous mangeons. Vous connaissez les «viandes mauvaises» de Pascal. J'ai eu le bonheur et l'honneur de lire de grands livres, de rencontrer des milieux exaltants, de me lier d'amitié avec des esprits profonds. Tout cela m'a nourri et, autre chance, s'est développé en moi comme ces pastilles japonaises que l'on jette dans l'eau et qui se changent en jardins fleuris. Il est clair que cet ensemble aurait pû demeurer une salade hétéroclite. La Chine ! L'Orthodoxie ! Le Compagnonnage ! Dostoievski ! L'Alchimie ! Les Romantiques allemands ! Jacob Boehme ! La Kabbale ! La Franc-maçonnerie ! Thomas Mann ! Le Soufisme ! Le Tao ! Les contes pour enfants ! Le Paléo-Christianisme ! Le Yiddish ! Tant d'autres, plus excitants, plus profonds, plus vifs les uns que les autres. Tout être humain connaît cette accumulation culturelle qui, dans certains cas plus prégnants, peut devenir existentielle. Ce trop-plein se niche plus ou moins bien dans la mémoire. Fatras de grenier ou de cave ? Ou bien réservoir organisé, dynamisé ?
Le jeu de l'écriture m'a aidé à incorporer ces multiples influences sans que ma conscience ait eu à subir les contradictions apparentes de ces divers enjeux. C'est qu'en projetant dans un récit onirique les images et les concepts, en les attribuant à des personnages, en les situant dans des événements, il me devenait possible de les situer dans l'invisible. Et cela, hors de tout contexte social, psychologique ou religieux, dans un dialogue non plus avec moi-même, mais avec un autre, attentif, que, par un tendre humour, je me permettrai d'appeler l'ange. Au vrai, pour employer un grand mot, il s'agit d'un épiphanisme. D'où le fait qu'instinctivement je n'écrivis que très rarement des données ayant un rapport direct avec ma vie. Ma personne sociale, le monsieur Baron de l'Industrie et du Fisc, n'eut jamais aucun accès à l'écriture, et d'ailleurs l'auteur Frédérick Tristan ne porte pas son nom.
Il y allait d'une bonne (et très mauvaise) raison : sous le coup d'une émotion vive, je perdis la mémoire à 9 ans, en mai 1940, mémoire de mon enfance, et, en prime, perte de la faculté de me souvenir de mes rêves nocturnes. Que l'écriture et la fiction aient été une enfance et un onirisme de remplacement, il se peut. En tous cas, c'est vraisemblablement le moteur qui me pousse si fort, si quotidiennement, à écrire, et cela depuis le funeste événement. Funeste et providentiel puisque c'est lui qui a fait de l'auteur cet écrivain bizarre que la critique a toujours tenu pour une exception dans le courant littéraire, et qu' aujourd'hui elle préfère oublier, n'en comprenant ni la démarche, ni le sens.
Très tôt, je fus confronté à la rébellion
Je n'aimais pas la société dans laquelle je me tenais. Au-delà de la crise d'adolescence qui surgit à travers les poèmes véhéments de Daniéle Sarréra, un véritable retournement du regard s'imposa. Cet œil intérieur fut, certes, critique, mais surtout, me semble-t-il, tourné vers les réalités spirituelles qui l'orientaient, fût-ce contre sa volonté d'analyser et de comprendre. Très vite, en effet, je compris qu'il n'y avait rien à comprendre, mais qu'il fallait s'ouvrir à la connaissance par le chemin du cœur. Non pas l'émotion, le sentiment, mais le cœur à droite tel qu'il est invariablement marqué sur la figuration du Christ en croix, et tel que Ramana Maharshi en parle à propos de la méditation et de la compassion profonde. Ainsi, l'épiphanisme que j'évoquais s'emplit-il de ce silence habité, mes romans n'étant que des anamorphoses d'une figure centrale que, ne fut-ce que par pudeur, je ne pouvais laisser qu'entrevoir. Encore, la plupart du temps, n'étais-je qu'un mercenaire de l'écriture au service d'un récit qui me dépassait. Récit forcément masqué, parce que les mots sont des masques et que la réalité n'est qu'une illusion commode qu'il importe de démasquer. Démasquer avec des masques ? En rajouter ? Voilà bien dans quel rouet l'auteur se retrouve investi. Citons Novalis : «On ne comprend pas le langage parce qu'il ne se comprend pas lui-même.» «Le vrai sanscrit, ajoutait-il, trouvait dans la parole sa finitude. La parole était sa joie et son être.»
Une autre façon d'envisager le récit s'impose à notre temps
La plupart des romanciers continuent leur petit bonhomme de chemin prosaïque: métro, boulot, dodo, avec des pincées de sexe ici et là. Ou bien ils tentent de briser la logique par le fantastique, la science-fiction, la psychanalyse... Or, déjà, la poésie vivante, celle de Rimbaud, nous invitait à être voyant, c'est à dire à regarder non plus du côté du psychisme mais du côté de la psyché. Ainsi la réalité utopique et uchronique de l'écriture devient-elle la demeure de l'invisible, le seuil des Intelligences, pontifex entre les mondes. Hermès ici s'allie fraternellement à Orphée. S'ouvrir à la langue intérieure du Verbe. La musica humana de Boèce qui fait écho à la musique des sphères, comme un miroir harmonique. Mais aussi entendre le pépiement des oiseaux, le frémissement des feuilles. Recevoir la rosée de l'Aube. Sans jamais rien demander. J'insiste: sans jamais rien demander, et accepter de recevoir. Dès lors la forme s'impose par elle seule. Elle n'est plus celle d'un auteur, mais celle de l'écriture du dedans, celle qui éclôt dans le cœur de l'esprit et se trace sur le papier par l'intermédiaire, le medium de la main.
Mais ici attention ! Tout cela est bel et bon, mais ce peut être un piège des fantasmes. L'illusion guette au creux du merveilleux. Les larves rampent au cœur du sublime. Et nous en revenons ainsi aux «viandes mauvaises». L'auteur peut fort bien, et même aisément, transcrire ses propres errances. Ce peut d'ailleurs être un témoignage utile et il est des folies qui ont ouvert des voies lumineuses par la vertu de leur insurrection. Je pense à Antonin Artaud, par exemple. Il faut casser le moule lorsqu'il ne sert plus qu'à réitérer la même insuffisance. En revanche, la méditation hermésienne, celle qui lance des ponts entre le visible et l'invisible ne peut que s'ouvrir sur la sympathie universelle, la Sophia des Grecs, l'harmonie des sphères de la Kabbale, le souffle créateur du monde imaginal cher à Ibn'Arabi et au Soufisme, le wei wouwei agissant du Tao. L'auteur parfois peut y prétendre et modestement avouer qu'il habite en cette aura, même si ce n'est qu'à l'entrée du temple, attendant avec patience que le mystère veuille bien l'entreprendre.
Le mystère ! Changer le masque en voile afin de tenter le dévoilement
Par l'imagination créatrice approcher à pas d'agneau de l'âme du monde qui est blottie en nous-même et qu'il suffit d'aimer pour qu'elle se déplie, se déploie, nous inonde de sa joie. En ce haut sens, la joie d'écrire (ou de peindre, ou de composer) vaut bien le bonheur d'aimer, puisqu'il s'agit foncièrement de la même substance, du même ravissement. Nous sommes ravis au monde, transfigurés dans les limites de la capacité qualitative de notre conscience. C'est le fameux verre de Virgile dans la Divine Comédie, toujours plein quelle qu'en soit la contenance. Et pourtant ce ne sont que quelques mots mais ils sont entrés en résonance avec le mystère dont ils sont issus. D'où l'importance du nom. Le nom qui est d'abord un signe, qui est d'abord un chiffre, qui est d'abord un souffle, qui est enfin l'accès à l'ange qui porte ce nom. L'ange qui est la figure d'une Intelligence, Intelligence qui se meut dans une hiérarchie cosmique, réellement spirituelle. En haut de cette échelle la Nuée lumineuse cache et révèle à jamais l'Insondable. Mais il y a participation, tout humble et mesurée qu'elle est, puisque nous sommes beaucoup de sable et un peu de lumière. Participation lorsque la parole ou l'écrit sortent du silence, un silence peuplé par la réminiscence d'un verbe originel. Participation parce que nous avons abandonné l'errance pour le pèlerinage à travers ce Mutus Liber qu'est l'univers visible. Ce Livre Muet nous désigne l'autre Mutus Liber scellé en lui, pareil pour nos yeux profanes à un rébus – un rébus incarné dans les choses ! Participation ou mieux communion par l'oeuvre, hésitante, la pauvrette, mais vivante, respirant à peine face à l'immensité de la vision qui s'infiltre parfois à travers les fissures de la porte. L'œuvre parce que l'auteur l'a choisi pour sœur, jadis, puis longtemps pour amante, enfin pour mère. Mère, car elle est le réceptacle où se forme et se fond l'écriture, le creuset, pourquoi pas le dérisoire et précieux vase alchimique où la transformation, la transfiguration s'opère. L'œuvre vierge et mère, oui, pourquoi pas, en analogie avec la matrice universelle, l'âme du monde.
D'ailleurs, la théorie des quantas a ouvert, à cet égard, d'incommensurables perspectives. Ces brisures du temps et de l'espace coïncident avec le morcellement de la pensée contemporaine. Ici Nicolas de Cues rencontre Niels Bohr. Le paradoxe fait enfin fi de l'évidence. Ce que l'on tenait hier pour des menteries, voire des élucubrations, deviennent des accès possibles à un ailleurs plus juste qu'un ici. L'écrivain peut et doit s'échapper du conformisme historiciste et de la linéarité du récit pour sonder les strates d'une réalité en sursis. Les deux grandes questions posées aujourd'hui sont : «Que se passe-t-il ?» et «Qui rêve qui ?». Réunis comme nous le sommes ce soir, nous sommes au sein d'un conflit du questionnement que seule la voie de l'esprit paradoxal peut tirer hors du marasme intellectuel.
Le grand secret est de changer le temps en densité
Souvent, lorsque l'un de mes proches m'appelle tandis que j'écris, c'est avec douleur que je m'éveille, ou plutôt que je romps avec l'éveil pour retomber dans la durée. J'étais si loin ! Et là, j'évoque à nouveau le «mystérieux sanscrit de l'âme» de Novalis. Comment le traduire en langue profane, comment oser ? Le récit de la fiction, en ce point critique, se doit d'être poiétique, issu du poiein, s'il ne veut pas trahir sa mission. Et certes, puisqu'il importe de communiquer à d'autres, et que ces autres sont frappés de stupeur, percevant en eux-mêmes l'écho d'anciennes réminiscences, il est nécessaire de trouver un langage du milieu, langage qui leur soit accessible bien que déjà il réclame d'eux une rupture. Ce langage du milieu joue sur plusieurs dimensions. Roman d'aventure, peut-être, qui, en fait, est un roman d'initiation, mais, au vrai, est un récit parabolique, lequel est ce que j'ai appelé tout à l'heure une anamorphose. Quatre étages d'entendement que l'on nommait jadis les quatre sens de l'écriture. Or il arrive parfois qu'un lecteur, plus rarement un critique, parvienne à l'état de compréhension intime du texte derrière le texte, ce que j'ai appelé la texture parce qu'elle est en-deçà et au-delà du texte lui-même, à la fois trame et dessin caché du tapis. Et ce lecteur de s'écrier: «Vous nous rendez à l'état d'enfance.» Il est vrai que d'un bouchon l'enfant fait une caravelle qui remonte l'Orénoque jusqu'à une île enchantée où une jeune fille merveilleuse l'attend, les bras chargés de roses – ou de petits pains au chocolat ! Je me reconnais assez bien dans cet enfant et dans ce bouchon-caravelle, et aussi dans l'Orénoque, et pourquoi pas dans la jeune fille aux bras chargés de fleurs enchantées. Néanmoins l'émerveillement ne suffit pas. Un moment du récit doit venir où un ogre surgit. Les contes de fée connaissent la nécessité de cette leçon. Parce qu'après tout, il convient d'apprendre aux gens de tenir le loup par les oreilles. Enfance, oui, mais pas enfantillage. Et mieux qu'enfance: enfantement. Chaque livre est un enfantement qui doit, à chaque fois, remettre en question l'idée même de livre. Parce que, tout simplement, un artiste doit se remettre sans cesse en question afin que son œuvre se poursuive en demeurant vivante et ouvert au sens. Et là, pas seulement par humour, je citerai Maître Chù lorsqu'il déclare: «Ne cherche pas. Trouve. Et ce que tu trouves, jette-le !» Bel exemple de pensée paradoxale, n'est-ce pas ?
Mes chers Amis, j'ai malencontreusement tenté un instant d'endosser le frac de l'intellectuel et je vous prie de bien vouloir m'en pardonner. L'écrivain ne devrait que proposer des textes et se taire. Que, du moins, mon petit discours soit témoin de la perplexe lucidité d'un ancien jeune homme qui, tant qu'il le pourra, écrira, poussé par ce que les Grecs appelaient si justement le daïmon et le poiein.
F.T.
Frédérick Tristan : "L'infinie poésie d'Hermès"
Propos recueillis par Olivier Gissey
Frédérick Tristan est depuis une cinquantaine d’années en France un des acteurs privilégiés du courant dit hermétique, ou mieux encore hermésien. Il nous apporte ici un précieux témoignage sur son parcours. Surgissent les figures d’Eugène Canseliet, René Alleau, Jean Tourniac, André Breton, Henry Corbin et bien d’autres. À travers cet entretien, Frédérick Tristan esquisse également une “bibliothèque idéale” qui n’oublierait pas l’apport considérable des chevaleries célestes iraniennes ou des sociétés initiatiques taoïstes chinoises !

Frédérick Tristan et René Alleau
Symbole : Quels ont été les grands événements de la pensée hermétique depuis un demi-siècle en France?
Frédérick Tristan : La seconde partie du XXe siècle fut marquée, en France, par un remarquable effort d’approfondissement des données éparses de la pensée et de la technique hermétiques grâce, tout d’abord, à une redéfinition de cette science au sein de la Tradition. La Révélation d’Hermès Trismégiste, l’astrologie et les sciences occultes de Festugière (1930) avait ouvert la voie. Il s’agissait d’une étude sur le Corpus hermeticum alexandrin qui, au Moyen-Âge, avait intéressé les alchimistes (en particulier l’ Asclepius) et à la Renaissance Marcile Ficin (surtout le Poimandrès).
Fulcanelli avait publié en 1926 le Mystère des cathédrales, et en 1910 les Demeures philosophales qui, en particulier grâce aux préfaces de Canseliet, devaient trouver un regain d’intérêt dans les années 50. En 1953, René Alleau publiait Aspects de l’alchimie traditionnelle qui devait se poursuivre, plus tard, par la fameuse collection “ Bibliotheca Hermetica”. André Breton et quelques Surréalistes assistèrent aux conférences sur l’alchimie données par Alleau, témoignant ainsi de l’intérêt du Mouvement pour certains aspects de cette science, de même que pour le René Guénon de la Crise du monde moderne (cf. préfaces de Breton à La Nuit du Rose Hôtel de Fourré, et au Miroir du Merveilleux du Dr. Mabille). Nicolas Flamel avait intrigué Breton sous un angle plus poétique que réellement hermétique ( Lettre aux voyantes, Second manifeste, Arcane 17, Nadja). De là l’idée me vint de remplacer le mot “hermétique” trop claustral par le mot “hermésien” plus ouvert et mieux adapté à une initiation hors frontières religieuses ou intellectuelles.
Telle était l’approche contrastée de l’hermétisme par le jeune homme que j’étais en 1950 au sortir des Grands initiés de Schuré que mon condisciple Guy Cazaril, le futur traducteur de Castaneda, m’avait fait connaître en classe de philosophie. La création de la revue Structure naquit sans doute de ce turbulent appel d’air, et en particulier l’article que j’écrivis à propos du premier numéro de la revue “ Le Surréalisme même", exaltant à la suite de René Alleau la Gradiva Rediviva de Jansen contre les jeux gratuits des néo-surréalistes. Ainsi Malcolm de Chazal, par un échange de courrier (il habitait l’Île Maurice), me fit rencontrer Breton qui devait me demander divers articles, dont un sur la magie destiné à son Art magique (article collectif qui finalement ne parut pas).

André Breton
Pouvez-nous nous parler de vos rencontres marquantes — des grandes figures que votre chemin a croisées sur cette voie ?
Pour moi, à cette époque, l’hermétisme se confondait volontiers avec un ésotérisme diffus considéré comme une approche existentielle d’ordre spirituel. Mes lectures de Gaston Bachelard et de Stéphane Lupasco mirent de l’ordre dans mon imaginaire troublé par les Romantiques allemands (« la Loge invisible »), qu’en particulier Marcel Brion m’avait fait découvrir. En fait, ce fut un peu plus tard, par mon engagement dans le Compagnonnage, puis dans la Franc-maçonnerie, et par ma rencontre avec Jean Tourniac, que ma réflexion sur l’hermétisme proprement chrétien se précisa. Je m’étais défié de la Tradition hermétique d’Evola, comme j’avais rejeté le Matin des magiciens et “ Planète”, témoignages jugés peu traditionnels voire confusionnistes et "païens", m’intéressant bien davantage aux “ Études traditionnelles” et à l’Alchimie de Titus Burckhardt. À cet égard, Charbonneau-Lassay et les Chevaliers du Paraclet que j’avais connus par les écrits de René Guénon et, plus directement, par René Nelli ( Lumière du Graal), m’inspirèrent très vivement. Les Sept instructions aux frères en saint Jean me furent transmises à cette époque. Je les confiai à Arma Artis, le valeureux éditeur de l’ Harmonia mundi de Georges de Venise. Marie-Madeleine Davy m’incita d’ailleurs à partager avec elle la responsabilité d’une collection “Spiritualité vivante chrétienne” où nous publiâmes, par exemple, le Miroir des simples âmes de Marguerite Porette et le Livre des œuvres divines d’Hildegarde de Bingen.
Vers 1970, Dominique de Roux avait conçu un numéro spécial des “ Cahiers de l’Herne” sur Guénon, et en avait confié la direction à Jacques Masui, le directeur de la nouvelle série de la revue “ Hermès”. Cette édition de “L’Herne” ne devait pas paraître du vivant de mon ami et fut d’ailleurs scindée en deux, l’une publiée à “L’Herne” et l’autre aux “Cahiers H”. Je participai à l’une et l’autre publications, leur confiant des extraits de mon journal plus particulièrement axés sur l’hermétisme chrétien exprimé par l’Orthodoxie et par la Franc-maçonnerie de tradition. Il me semblait, en effet, nécessaire de témoigner de la réalité vivante d’Hermès au sein de ces deux assemblées initiatiques.
Les “ Cahiers de l’Hermétisme” que nous créâmes, Antoine Faivre et moi, en 1977 furent conçus dans un esprit pluridisciplinaire afin de retrouver le fil des traditions hermésiennes ne se limitant pas au contexte alexandrin, mais dont la conception de l’homme et du monde s’était manifestée dès les présocratiques jusqu’à nos jours en passant par l’alchimie, la kabbale juive ou chrétienne, la pensée de Paracelse, de Boehme, de Saint-Martin… Notre comité s’honora des apports et des conseils d’Henry Corbin, de Gilbert Durand, de Mircea Eliade, de Henri-Charles Puech, auxquels vinrent au fil des études se joindre des spécialistes comme André Savoret ou Bernard Husson, d’autres chercheurs amis comme Jean Canteins, Pierre Deghaye, Jean Tourniac, Armand Abecassis, Bernard Gorceix, Marie-Madeleine Davy, Roland Edighoffer, noms que l’on devait pour la plupart retrouver lors des colloques de l’Université Saint-Jean de Jérusalem, dominés par la haute personnalité du Professeur Henry Corbin.

Hermès a tant de patries ! En Iran, en Chine, pays que vous connaissez…
Ce fut d’ailleurs grâce à l’auteur de En l’Islam iranien que nous pûmes aborder l’œuvre d’Ibn’Arabi et de Sohrawardi sous un angle plus certainement hermésien, lors de réunions que Henry eut l’amitié fraternelle d’organiser pour le petit nombre qui étudiait sérieusement ces questions. Je me souviens avec émotion d’un soir où il évoqua l’ascension extatique d’Hermès selon la tradition des Ishrâqîyûn dont l’origine remonterait à la sœur d’Hermès (son essence féminine). Montée prodigieuse dans le monde du Malakût vers la "Lumière de Gloire".
Dans le même temps nous dirigeâmes, Faivre et moi, la publication d’œuvres non encore traduites ou introuvables de C.G.Jung telles que le Mysterium conjunctionis, le Commentaire sur le Mystère de la Fleur d’Or, ce dernier ouvrage rencontrant mon intérêt pour le Tao et, plus particulièrement, pour la société initiatique des Houng (la Tien Ti Houei) dont Pierre Grison m’avait fait connaître l’existence, et que mon ami Chou Lin Gin me permit d’approfondir à la suite de mes séjours en Extrême-Orient. Ainsi la notion d’hermétisme (ou, plus simplement, le vif et tenace sentiment que j’en avais) se précisa dans mon esprit dans des directions différentes, m’apprenant qu’il s’agissait d’un seul et même flux intérieur sous le signe d’Hermès, dieu des carrefours et des échanges.
Nous revenons aux fondements de cet “art” ou de cette “science” bien souvent galvaudée. Il faut sauver le vrai hermétisme !
En 1974, une importante rencontre radiodiffusée (France Culture) entre René Alleau et moi nous permit en effet de mieux situer ce que nous entendions l’un et l’autre par la notion de "sciences ou arts hermétiques" : Alleau, en tant que savant, demeurant fidèle à un processus alchimique fondé sur des règles traditionnelles rigoureuses (et donc une science), et moi, en tant qu’écrivain, témoin d’une magie existentielle fondée sur l’incarnation du mystère à travers l’œuvre (et donc un art). À l’époque cette distinction s’imposait. Elle est encore aujourd’hui une pierre de touche indispensable.
Les articles décisifs que René Alleau donna à l'Encyclopedia Universalis sur les entrées Alchimie, Astrologie et Magie demeurent, en effet, d’une précieuse actualité à l’heure où un dévergondage pseudo-initiatique tente d’utiliser ces techniques traditionnelles hors de propos. En revanche, il reste profitable que la réalité vivante et intériorisée de l’hermétisme puisse coopérer à ces mêmes techniques en les dynamisant à travers une créativité proprement "poétique". Comme le soulignait André Breton , "le merveilleux se situe à l’extrême pointe du mouvement vital".
Bibliographie succinte :
Alleau R. La science des symboles, Payot, 1977.
Alleau R. De la nature des symboles, Payot, 1997.
Bonardel F. L’Hermétisme, P.U.F., 1985.
Bonardel F. Philosophie de l’alchimie, P.U.F., 1993.
Faivre A. (dir.) Présence d’Hermès Trismégiste, Cahier de l’Hermétisme, Albin Michel, 1988.
Faivre A. The Eternal Hermes, Phanes Press, 1995.
Gilis Ch-A. Le Coran et la fonction d’Hermès, Ed.de l‘Œuvre, 1984.
Klossowski de Rola, The Golden Game, Thames and Huston, 1988.
Obrist B. Les débuts de l’imagerie alchimique (XIII° - XV° siècle), Le Sycomore, 1982.
Yates F. Giordano Bruno et la tradition hermétique, Dervy, 1988.
La divine comédie de Frédérick Tristan
Par CEAPT Symbole copyright, vendredi 30 mars 2007 à 10:59 - Frédérick Tristan - #67 - rss
par Jean-Marie Beaume
Chez Frédérick Tristan, maître de la langue et prince de la Fiction, l’art du roman confine (sur)naturellement à la métaphysique. Avec Dernières nouvelles de l’au-delà il nous entraîne, entre «rêve» et «réalité» dans la fabuleuse ronde des «morts» et des «naissances». Perdus dans le kaléidoscope du courant des formes et l’illusion de la «foultitude», ses héros se verront appeler à une «rectification du regard» : un retournement mémorial et une remontée à la source, qui participent du fameux jeu de mots grec : le souvenir (du Nom) est absence d’oubli (alêthê), qui est elle-même vérité (alêtheïa), qui est elle-même sentier divin (alê theia)… Un roman magistral, librement inspiré de la Divine Comédie, où Frédérick Tristan invite peut-être aussi «celui qui a des oreilles pour entendre» à perdre, avec lui, le sens de toute mesure possible du “réel”, pour mieux contempler sa longueur, sa largeur, sa hauteur et sa profondeur, qui ne sont pas de ce monde…

Gambier, psychanalyste de renom, reçoit un jour d’un de ses patients, le singulier Alphonse Donatien de Granville, un curieux manuscrit ; il y raconte comment il se trouve sommé d’écrire l’invraisemblable histoire d’un certain Nemo, personnage sans relief, comptable de son état, louchant sur les appâts d’une dame Gandois, épouse de militaire — et par dessus le marché, définitivement mort !
Remettre l’envers à l’endroit
Gambier plonge dans le récit de Granville, qui se révèle vite un fabuleux théâtre, où chaque personnage, apparemment, en entraîne un autre dans la ronde — mais quel «autre» ? Et d’ailleurs qui «je», qui «moi» ? L’insignifiant Nemo dont l’existence fut «un chef d’œuvre du rien», passe le témoin à l’arrogant milliardaire Frazer, qui lui-même le remet au pasteur Strawberry «trop engoncé dans la théologie» ; la pitoyable Gladys, prostituée de son état, le transmet à son tour à l’écrivain Malonne, veuf inconsolable, qui ne sait plus s’il est dans une histoire qu’il a lue ou qu’il a écrite — puis, encore, à Marco Cesare, amoureux d’un songe qui finira par s’effilocher pour lui révéler le visage d’un souvenir d’enfance, d’«une petite fille très ancienne»… Et ainsi de suite jusqu’à la griserie et au vertige — car les «morts» et les «naissances» auxquels sont soumis les personnages apparaissent comme autant de changements d’état tout à la fois considérables et imperceptibles. Du cabinet de Gambier à la terrasse du café de nulle part ou au salon vénitien de la Boccadoro, le glissement est comparable au passage de la veille à l’état de rêve, ou du rêve éveillé au songe à dormir debout : la réalité y devient gazeuse et les logiques n’obéissent plus aux mêmes lois. Dans cette ronde tantôt macabre, tantôt burlesque, des visages viennent à tour de rôle dans la lumière, puis disparaissent, ou plutôt se transforment, se modifient tout en restant le même. Ne faut-il pas «mourir souvent pour être bien né» comme l’apprend, aux incrédules qui se demandent ce qu’ils font là, un certain officier, rescapé de bien des guerres, dont la devise est : «Ferme sur les bases» ? De vie à trépas, les dés roulent, la main passe. Et Satan conduit le bal ?
Volens nolens, nul ne semble en tout cas pouvoir échapper à la loi commune des “morts” et des “naissances” (dont l’auteur prend soin de préciser, au passage, qu’elle ne saurait être confondue avec les théories réincarnationnistes) : les uns après les autres, tous les personnages de cet étrange théâtre (ou de son double, car qui est mort ? Qui est vivant ?), devront descendre au sous-sol (la porte donnant sur l’escalier est derrière le comptoir), glisser une pièce dans le tourniquet, puis traverser la salle de bal. Ils se verront encore confrontés à la «Grande Madame» — sorte de Mère Mac Miche «qui se croit la mère du monde», mi goule mi ogresse —, avant d’entrer dans une mystérieuse machine, Grande Centrifugeuse dont la réparation n’est certes pas le moindre des problèmes !
Au milieu de tant de vicissitudes, de tours de manège et de coups de théâtre, la douce et matutinale figure de «Béa», aussi belle que le printemps, apparaît vite comme un guide providentiel. N’aurait-elle pas été leur premier amour ? Se pourrait-il qu’elle soit encore, au fond d’eux-mêmes, leur seul port d’attache — que cette remémoration de la source d’amour originelle pût changer la donne et modifier le jeu ? Nos héros devront expérimenter ce retournement mémorial et cette remontée à la source, dont le fameux jeu de mots grec pourrait bien donner la clef : le souvenir (du Nom) est absence d’oubli ( alêthê) ; l’absence d’oubli est vérité ( alêtheïa) ; la vérité est sentier divin ( alê theia)… Si le monde est une chimère, si la mort n’est plus qu’une récession, n’est-ce pas parce que tout a été mis à l’envers et que la grande affaire de l’existence est de tout remettre à l’endroit — ou plutôt de parvenir à dépasser et abolir ces oppositions ? «Depuis que la machine est devenue folle, fait dire Frédérick Tristan à l’un de ses personnages (…) le temps et l’espace se sont emmêlés, formant un inextricable nœud. Or, ce nœud est aussi une faille, une sorte de trou noir dans lequel les identités ont été absorbées. L’univers s’est changé en un kaléidoscope aux variations aléatoires. Rêve et veille ont perdu leur sens. Pis encore : vie et mort se sont fondues en un seul récit paradoxal». En retrouvant sa «Béa», l’insignifiant Nemo finira par refaire, guidée par elle, le voyage qui le conduira jusqu’au laboratoire du Grand Occuliste où cette rectification du regard peut enfin s’opérer en «remettant l’envers à l’endroit»…
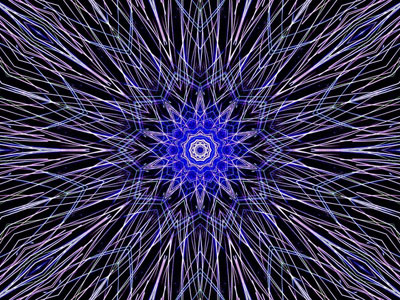
"L’univers s’est changé en un kaléidoscope aux variations aléatoires. Rêve et veille ont perdu leur sens. Pis encore : vie et mort se sont fondues en un seul récit paradoxal."
Celle qui n’habite aucun nom
À ce stade, de bien troublants secrets vont être révélés à Monsieur Nemo ! Le révérend Strawberry avait déjà eu l’intuition que, peut-être, «il n’y a jamais eu qu’un seul être humain sur la terre, une seul conscience», que tout le reste «n’est que le théâtre de son esprit» ; Nemo devra encore apprendre, sans toujours bien comprendre, qu’il «n’exista jamais qu’un seul homme, qu’Adonaï créa dès la première étincelle du premier jour (…), un seul être humain à l’image du Grand Homme créé lors du bereshit», et vivant «dans un seul temps, hic et nunc», mais ayant perdu la conscience de l’Unité et croyant «voir une foultitude». Ce n’est jamais que «le joueur de bonneteau» qui n’en finit pas de nous bluffer «avec ses manigances». Celui-là n’est que «l’Ombre. Ou plutôt l’ombre de l’Ombre. Lorsqu’il choisit d’apparaître, il prend les formes les plus inattendues, les plus déroutantes, et, au vrai, les plus fallacieuses. Alors, les oiseaux se taisent, le gibier se cache, le soleil se couche, la lune ne se montre plus. Ce monsieur Grimace est multiple, capable de se glisser en mille endroits, épiant les uns, traquant les autres, et toujours empochant la mise. Il se veut saltimbanque de l’absolu et ne véhicule que le néant.» Nemo finira par comprendre qu’il doit le rejeter pour expulser hors de lui-même ses doubles de ténèbres — et Gambier que «nous nous sommes créés un personnage, parfois plusieurs» mais qu’«au fond, nous ne sommes personne». Vanité de la psychanalyse ; vanité du «moi» — vanité des vanités : la découverte du pot aux roses annonce le fin mot de tout. Elle rend possible l’extinction des feux, la dissipation des chimères, l’ensevelissement dans le silence régénérateur de «notre Mère à tous, la seule et unique Grande Madame, invisible aux yeux, inscrite dans les cœurs, (…) pur concentré de bonheur et d’amour» : «certains l’appellent la Vierge, d’autres Kouan-Yin, mais elle n’habite aucun nom. Elle est le vent, l’esprit, l’éclat de lune sur l’étang nocturne, l’étincelle de joie dans le regard d’un enfant. Vous voyez ? Vous voyez ?»
C’est tout vu ! Et que le lecteur se rassure : il pourra sortir du roman de Frédérick Tristan comme si de rien n’était, c’est-à-dire bien vivant, pour réintégrer l’ordre rassurant des références savantes et du «discours sur» ; pour peu qu’il soit pressé de retrouver le plancher des vaches, la stabilité de ce monde-ci, il sera libre, par exemple, de n’apercevoir dans ces Dernières nouvelles de l’au-delà, qu’une habile fiction inspirée de la Divine Comédie. Gambier — et, tour à tour chacun des autres personnages, qui n’en sont jamais que des modifications secondaires transitoires —, n’est-il pas assimilable à Dante guidé par Béatrice («Béa») de «l’Enfer» au «Paradis» en passant par le «Purgatoire» ? Chaque personnage n’apparaît-il pas, au cours de ces «voyages », comme la personnification d’une passion ou d’une vertu ? Gambier, qui incarne longtemps la «raison» scientifique ne pourrait-il être assimilé lui-même à la figure de Virgile dans la Divine Comédie, avant de se laisser conduire au paradis par l’humble et douce Béatrice ? En somme, rien n’oblige ici celui qui a des yeux mais qui ne voit pas, des oreilles, mais qui n’entend pas, à dépasser le stade de la lecture allégorique d’une œuvre littéraire. Mais le lecteur qui sait (ou qui a l’intuition) que la Divine Comédie elle-même est une œuvre dont le sens profond, comme l’a montré R. Guénon, est «métaphysique dans son essence» et «initiatique» (1), se verra peut-être suggérer, ici, une tout autre lecture, non moins jubilatoire que l’autre — car notre auteur, maître de la langue et prince de la Fiction, est un prodigieux romancier ! —, mais éminemment sapientielle.
Contentons-nous de noter, à cet égard, que pas un des 56 chapitres de cet extraordinaire roman ne recèle une véritable leçon spirituelle ou métaphysique, et que les 55 premiers ayant conduit le lecteur jusqu’à l’entrée d’une certaine grotte, au flanc d’une montagne située dans un jardin, au centre d’une île, le 56ème lui ouvre rien de moins que la perspective de l’ascension des «états multiples de l’être»… «Le baron demanda à son compagnon d’attendre devant l’entrée tandis qu’il pénétrait dans l’amas rocheux pour avertir le gardien de leur venue. Gambier s’aperçut alors qu’un arbre colossal avait pris racine au sommet de la grotte et que ses racines l’entouraient comme pour la protéger. Cet arbre était d’une taille si élevée qu’aucun regard n’aurait pu en distinguer la cime. Une source vive jaillissait à son pied, à droite de l’ouverture de la caverne. Le chant de cette eau était si harmonieux que les oiseaux eux-mêmes se taisaient pour l’écouter.»
Que celui qui a des oreilles, entende !

"Si le monde est une chimère, si la mort n’est plus qu’une récession, n’est-ce pas parce que tout a été mis à l’envers et que la grande affaire de l’existence est de tout remettre à l’endroit — ou plutôt de parvenir à dépasser et abolir ces oppositions ?"
Du mot qui crée au mot qui sauve
La question de savoir si Frédérick Tristan est romancier ou métaphysicien n’a que peu d’intérêt : il est évident qu’il est les deux, moins peut-être par goût du roman et de la métaphysique — comme on dirait d’un fin gourmet qu’il aime le veau Orloff et les crêpes Suzette — que parce que l’art du roman, chez lui, confine (sur)naturellement à la métaphysique. Il faut comprendre l’œuvre de Tristan comme une tentative absolument folle, et peut-être sans véritable précédent, mais nullement désespérée, d’épuiser le «réel» (ce qu’il est convenu de désigner par ce mot avant qu’on commence à douter qu’il ait le moindre sens commun). Non pas de décrire le réel (nul écrivain, à cet égard, n’est moins réaliste), ni même à proprement parler de l’explorer, mais d’en suivre les lignes de fuite pour mieux se fondre dans ses ombres et dans ses lumières, d’en épouser les sinuosités et les entrelacs pour s’immiscer entre ses paradoxes et en éprouver les subtiles contradictions — thèse, anti-thèse et prothèse, Masques et Bergamasques ! Ce qui intéresse Tristan ce n’est pas la «forme» (matérielle) du réel, avec sa solidité illusoire et ses vaines dimensions rassurantes ; c’est de s’abîmer dans le flux et le reflux incessant de ses miroitements et de ses sortilèges pour trouver la passe entre la combustion et le feu — c’est de perdre le sens de toute mesure possible du “réel” pour contempler, un court instant (et laisser entrevoir à son lecteur subjugué !), sa longueur, sa largeur, sa hauteur et sa profondeur, qui ne sont pas de ce monde. Un court instant, car ce vin fort n’est pas fait pour toutes les veines et surtout parce que nous sommes là, on l’aura compris, dans une littérature des confins, sur un chemin des douaniers qui va et vient d’un ordre de réalité (ou de surréalité) à l’autre, où les frontières, comme tout le reste, ont un caractère fictif et aléatoire. On pourrait craindre de se perdre dans ce qui apparaîtra peut-être comme une sorte de “jardin enchanté” à ceux qui sont sans imagination et sans courage, et qui croient que les contes sont écrits pour faire peur aux enfants ! Frédérick Tristan, pourtant, n’a jamais égaré ses lecteurs — pas plus qu’aucun de ses héros, du Balthasar Kober des Tribulations Héroïques (2), à Xi Fei de Tao, le Haut Voyage (3) en passant par Ali, le charpentier de L’Amour pèlerin (4). Ce qui est vrai, c’est qu’il les met toujours en présence d’un jeu divin, qui peut les éprouver jusqu’au vertige et à l’éblouissement, et qui n’est autre que la mise en roman du mystère même de la Création (à moins que celle-ci ne soit elle-même une fiction et Dieu le Grand Romancier de l’Univers et des Mondes ?). Peut-être faut-il comprendre, comme ici encore avec ces Dernières nouvelles de l’au-delà, que puisque le mot crée, autrement dit puisqu’il renvoie à l’acte créateur lui-même, la seule quête qui vaille n’est autre que celle du mot qui sauve, enfoui dans le Grand Silence de l’au-delà de tout… ?
J.-M.B.
|