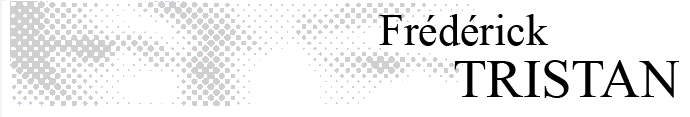Frédérick TRISTAN, Monsieur l’Enfant et le cercle des bavards, Fayard, 2006.
Le club des hétérosophes imaginé par Frédérick Tristan regroupe ceux qui cherchent une autre sagesse. Six membres triés sur le volet s’y retrouvent, avec l’indispensable septième : six sont les jours de la Création, sans le septième, celui où Dieu se repose, celle-ci serait diabolique. Le septième de ces bavards, assis à l’écart, est Monsieur l’Enfant, tenu pour fou, et muet.
Dans ce club fermé et sélect, nos six hauts personnages jouent au compagnonnage, sous la présidence du descendant d’une grande famille, un banquier asiatique assurant la trésorerie et un écrivain aux thèses hardies le secrétariat. Ils bavardent de grands sujets dont ils ne connaissent rien : « est-il vraiment nécessaire de connaître un sujet pour en parler durant des heures ? » se demande l’un d’eux. De belles formules suffisent à tenir en haleine une assistance, comme celle-ci, sur laquelle il termine son intervention : « L’homme est le ventriloque de l’univers. »
Et pourtant, ce bavardage n’est pas une activité innocente. Lorsqu’ils choisissent pour sujet le langage, c’est même la meilleure manière d’en dénoncer les pièges, non en les déjouant, mais en tombant dedans de manière si voyante qu’ils les signalent à tous.
Surtout, le bavardage permet de cacher les véritables problèmes, les secrets de guerre trop vite étouffés, les calculs sordides, les intérêts mesquins. Les hétérosophes ensevelissent le monde sous les mots, sous les anecdotes pittoresques, les hypothèses farfelues, les collections surréalistes (comme une symbolique collection de buvards !), les inventions saugrenues (comme le « piège à imagination » nommé Onanic 69)... Méfions-nous de la fable : elle contient un autre langage.
Le véritable langage, cependant, est celui du muet, dont la vocation, dans la « prostitution de la parole », est de faire s’élever du silence une parole neuve : l’« étrange et poignante musique » entendue le jour de sa naissance, la « vibration d’amour » que les hommes ont perdue — « trop de silence éparpillé, trop de mots dilapidés : on n’entend rien. » Monsieur l’Enfant, au milieu du cercle des bavards, redécouvre la poésie, dont on se prend à regretter, à lire ces textes, que Frédérick Tristan n’y ait eu plus souvent recours.
Frédérick TRISTAN, Le fabuleux bestiaire de madame Berthe , dessins sur le vif de Paul Bergasse, Paris, Zulma, 2005.
La fantaisie semble avoir guidé la main de Paul Bergasse, qui a créé vingt-huit animaux fantastiques, tout en dentelles, en volutes, en arabesques dantesques et en excroissances biscornues. Mais la fantaisie est la porte royale de l’imaginaire, où règne madame Berthe, héroïne récurrente de Frédérick Tristan. Elle ne pouvait faire moins que de faire rechercher de par le monde cette faune abracadabrante où l’on reconnaît, à l’occasion, la trompe d’un éléphant ou le bec d'un canard. L’auteur — à moins qu’il ne s’agisse d’Adrien Salvat ? — leur a donné des noms, et une histoire. Du trisophon barbulé à l’histéropathe fragmenté, du tutrude masqué à l’hibousine surgissante, ils s’offrent à la plus fabuleuse des sciences : celle de l’imaginaire, à laquelle appartient comme on le sait la pataphysique, science des solutions imaginaires. Mais à la différence d’un livre de biologie, les animaux de madame Berthe sont porteurs de sens. Comme dans tout bestiaire fantastique, ils semblent appartenir à diverses espèces, voire à des ordres, des classes ou des règnes différents. Mais ils changent également de milieu, comme la seiche sacerdotale qui se gonfle comme un ballon, remonte du fond de l’océan et se laisse porter dans les airs. En revanche, ces êtres en constante mutation ne se laissent pas fixer. La seiche sacerdotale, dès qu’elle est touchée, « tourne en boue »; le chant merveilleux de l’histrapode musicien preceptible par l’oreille humaine, ne peut être capté par une bande magnétique; le coq Maer n’est exposé qu’empaillé; l’anarchal sublime ne cesse de se transformer en insecte malgré sa capture... Parfois, le spectateur lui-même se retrouve dans cet état intermédiaire, comme celui qui a eu l’imprudence de dévoiler en même temps la cage du tatsu et celle du clopsu, dont les cris éveillent respectivement l’angoisse et la joie. Mais n’est-ce pas le propre de l’imaginaire de révéler nos propres abîmes et nos propres contradictions ? Peut-être parce que, comme le crabe Sifu, « il naquit dans notre âme avant d’apparaître dans les grands fonds. »
Frédérick TRISTAN, L'amour pèlerin , Fayard, 2004
Un charpentier de Bagdad, après avoir perdu dans un incendie sa femme et ses deux enfants, fuit dans le désert, désespéré et reniant Dieu. "Ton âme s'est rétrécie à un point tel qu'elle ne supporte plus la lumière", lui dit un berger de rencontre. Mais les rencontres sont-elles fortuites, s'il voyage avant tout en lui-même ? Au fond de son désespoir, il doit comprendre qui est réellement la Jamila qu'il a perdue, qui le guide sans qu'il le sache comme Béatrice mène Dante vers les hauteurs éternelles. Sa révolte le ramène plus sûrement à la sagesse que la religion, qui se contente de réciter. Lorsqu'il l'aura épuisée, il aura découvert en lui les millions d'êtres humains qui habitent son corps et son esprit, et il connaîtra la place qui lui est assignée — et qui est assignée à tout homme — dans le grand dessein de la Création — création divine ? création personnelle ? Qu'importe, en fin de compte, puisque la création est en lui.
Roman initiatique brassant une matière mythique issue de toutes les cultures, sous l'habit chi'ite, L'Amour pèlerin, annoté par Jean-Arthur Sompayrac et présenté par Adrien Salvat, familiers des lecteurs de Tristan, multiplie les clins d'œil à diverses traditions qui ont nourri son œuvre. Le charpentier Ali aurait pu être christ ou boddhisattva, et s'il réconcilie en lui les deux grandes religions monothéistes, c'est que leur germe, avec celui de l'humanité tout entière, a été planté au fond de sa révolte. Boiteux du nom, comme bien des néophytes, il croit avoir perdu toute raison de vivre. Mais un chien, fidèle compagnon des charpentiers comme des saints pèlerins, le guide dans son parcours intérieur.
Frédérick TRISTAN, Le manège des fous , roman, Paris, Fayard, 2005.
"Ainsi, vous avez compris qu'un autre monde vit dans le nôtre, et d'autres mondes encore dans cet autre, emboîtés les uns dans les autres dans le même espace et le même temps." Voilà longtemps que les lecteurs de Frédérick Tristan l'ont compris, et ont compris que tous ces mondes sont aussi des romans emboîtés les uns dans les autres, qu'ils soient signés Tristan, Abercombrie, ou...
Qui s'était résigné au départ de madame Berthe, à la fin de Dieu, l'Univers et madame Berthe ? Sûrement pas Frédérick Tristan, ni le jeune Hugo, élevé jadis par elle, ni le vieux Grabar, un de ses familiers, ni tous ceux qui l'ont approchée. Pour la rejoindre, Hugo, comptable dans le civil chez un taxidermiste, ne dispose que de ses cahiers et de ses crayons. Il écrit, et les mondes à nouveau se confondent. La fenêtre d'Ageüs (rapportée, pour les intimes, du manoir de Bourdonné) s'ouvre alors sur l'autre monde, non pas le monde des morts, mais celui de la fiction, la doublure de l'univers absurde, là où tout devient sens. Le collectionneur d'animaux empaillés révèle sa nature diabolique, et au grand dam de son patron taxidermiste, Hugo, nouvel Orphée, va délivrer de cet enfer son âme momifiée. Tout cela dans un délire qui ne manque ni d'humour, ni de panache. Rarement Frédérick Tristan n'avait laissé à ce point libre cours à sa verve romanesque, dans une "grande épiphanie de l'incongruité, révolution ma soeur, tout cul par-dessus tête, les fleuves remontent à la source, les astres chantent le Veni Creator, le soleil d'hiver au fond du puits." C'est drôle, truculent, dément et sage.
Tout cela a du sens, pour le familier de son oeuvre, mais un sens perpétuellement remis en question, car il a la suprême sagesse de ne jamais s'imposer au lecteur. "Tu es toi-même le livre que tu écris"; révèle le romancier Abercombrie. Et comment écrire celui-ci ? Comment embarquer, à notre tour, sur la Marie-Jeanne qui a emmené madame Berthe ? En y croyant, tout simplement, et en sachant, avant de le chercher, ce qu'est l'océan, ce vaste territoire de l'imaginaire. "Si nous croyons qu'on bout du tunnel s'ouvre l'océan, c'est que nous avons déjà plein de mouettes dans le
coeur."
Frédérick TRISTAN, L’anagramme du vide, Bayard, 2005.
« Mais – interrompront certains – qu’est-ce que ce bavard histrion nous raconte ? » De quel droit un écrivain parle-t-il de Dieu, quand vingt siècles de théologie s’y sont cassé les dents ? Qui connaît l’œuvre de Frédérick Tristan sait combien son discours est légitime. Non seulement parce que Dieu est un de ses personnages, sous son nom chrétien, chinois, musulman, ou sous l’hétéronyme de madame Berthe, mais parce que la quête intérieure structure le moindre de ses récits. Et c’est bien de cela qu’il est question dans ce livre. Très vite, on dépasse les conceptions plus ou moins anthropomorphes de la divinité (l’idole) et ses avatars métaphysiques (l’icône) pour se référer à la tradition de la mystique apophatique, celle qui ne conçoit qu’un Dieu sans forme et sans attributs, dont le nom est si curieusement l’anagramme du vide. Et si l’homme a créé Dieu à son image, n’est-ce pas par inflation pathologique de son ego, cette « marionnette que notre vanité s’est créée et qui peut devenir notre tyran » ? Chercher Dieu en dehors de notre reflet fini et mortel, c’est dépasser les suggestions de l’ego et, paradoxalement, descendre au plus profond de soi pour y découvrir la petite étincelle de néant qui réalise en nous le Dieu sans forme. Un paradoxe sur lequel s’est construite l’œuvre romanesque de Frédérick Tristan, dont les personnages parcourent leur propre conscience en voyageant par le monde, et qui rejoint l’ « agir dans l’immobile » de maître Eckhart. Aussi est-il tout naturel de passer de l’expérience intérieure à la fiction, au sens fort du terme, celle qui « permet au langage d’incarner l’inexprimable ». Si la vie, dans ce monde d’apparences et de conventions que les civilisations se sont aménagé pour le rendre supportable, n’est elle-même qu’une fiction que nous nous racontons à nous-mêmes, « l’art du récit peut permettre la mise en abyme de ce récit qu’est l’existence. »
Un petit livre d’une densité exceptionnelle, car nourri à la fois d’une profonde érudition, d’une quête sincère et d’une expérience marquante. Sans didactisme ni pédanterie, il aborde les thèmes essentiels avec un humour respectueux et un incontestable sens de la formule (« nous barbotons dans l’aporie », « Dieu, dans cet état, devient l’alibi béat du conformisme »…).
Frédérick TRISTAN, Dernières nouvelles de l'aud-delà, Fayard, 2007.
« Écrire un roman, c’est ériger une tour dont l’architecture est perverse. — Pourquoi devrait-elle l’être ? — Parce qu’elle aussi nous ressemble. »
Sans doute est-ce ce que pensera un lecteur qui découvrirait par ce roman-ci l’œuvre de Frédérick Tristan. Rarement il aura été aussi loin dans son entreprise de déstructuration du réel. Le roman de Némo, qui, en s’éveillant le matin, s’aperçoit qu’il est mort, va bouleverser la vie de celui qui croit l’écrire, du psychanalyste à qui il se confie, et d’une kyrielle d’identités tout aussi évanescentes dans lesquelles se réincarne Némo, obligées l’une après l’autre d’affronter la même mort. « Le jeu des masques ne finit jamais », et la mort n’est que le plus grimaçant d’entre eux.
Nous suivons ces personnages graves ou farfelus, falots ou pédants, à travers des univers imbriqués qui retombent sans cesse aux mêmes endroits, une terrasse de café, l’appartement d’une courtisane, dont les sous-sols semblent communiquer avec les lieux les plus insolites et les plus éloignés. À chaque fois, il nous semble être un peu plus perdus ; à chaque fois, nous franchissons une strate dans la compréhension du roman. Comme dans l’enfer de Dante, nous passons de cercle en cercle. Après le cercle des premiers fantasmes, on pénètre chez le maître des métaphysiques subalternes, puis chez le maître de la fiction, qui gère le possible et l’impossible, avant de rencontrer le grand oculiste ou le maître du désert.
Y comprenons-nous davantage ? Surtout pas, le but étant de briser les unes après les autres les explications logiques que nous pourrions donner à ce récit débridé. Car les explications ne manquent pas. Les personnages viennent de mourir, mais lorsque tout s’éteint, le cerveau continue à fermenter un peu ; l’univers ne tient que par le regard que le protagoniste porte sur lui et disparaît avec lui ; notre cerveau fabrique la réalité à partir des données pulvérisées du réel ; nous sommes tous au théâtre, ou dans un roman que personne n’a jamais écrit, ou dans une anamorphose textuelle ; le réel est comme une pâte feuilletée, ou comme un ruban de Möbius ; nous vivons des fractures successives du continuum temporel... Théologiens, physiciens spécialistes des quantas, narratologues sont tour à tour appelés à la rescousse et assènent avec le même pédantisme les mêmes ineptes certitudes. Toutes les explications sont tour à tour balayées. « D’ailleurs, ceux qui se vantent d’y comprendre quelque chose sont soit des menteurs, soit des imbéciles. »
Il faut se laisser porter, surprendre, faire semblant de comprendre, et, comme Dante avec Béatrice, suivre la jeune fille dont, peut-être, nous avons été amoureux dans une jeunesse perdue. Béa, oui, elle s’appelle Béa. Et si elle nous emmène vers les images redoutables d’un père manipulateur et d’une mère castratrice, c’est parce que la machine à raconter les histoires s’est emballée. Derrière, il nous faudra retrouver la Miséricordieuse, ceux que les Chinois ont appelée Kouan Yin et les chrétiens, Notre Dame. Alors, peut-être admettrons-nous qu’on ne pénètre pas le monde par la logique, mais par l’abandon.
Ce roman est un kaléidoscope dont les débris colorés seraient les romans antérieurs de Frédérick Tristan. On songe à La geste serpentine, pour les fractures spatio-temporelles qui ramènent sans cesse les personnages au même endroit ; à l’univers de Madame Berthe, dont la maison communiquait avec le monde entier ; au Dieu des mouches, pour l’ombre inquiétante du père ; au Singe égal du ciel, où l’on accède tout à tour à des strates supérieures de la réalité incarnées par des bouddhas successifs tout aussi inconsistants ; à l’Homme sans Nom, pour le personnage de Némo... Nous sommes tout simplement dans un des plus fabuleux roman de Frédérick Tristan
Frédérick TRISTAN, Le chaudron chinois, Fayard, 2008.
Dans une Chine du XIe siècle qui ressemble par moments aux coulisses de notre monde, Li Ti-Phang, lettré de première classe, rêve qu’il est Li Ti-Phang, enfant autiste nourri de littérature ancienne au point d’en oublier la vie. Lequel rêve l’autre, se demanderait le Cidrolin de Queneau ? La question ne se pose pas longtemps, dans un univers qui n’est jamais qu’une pâte feuilletée. Le lettré condamné à s’écrire dans une autre dimension de lui-même finit par être absorbé par le récit, qui se plie et se replie indéfiniment sur lui-même. Comme une pâte feuilleté, lui aussi.
Ti-Phang, qui se prend pour un dragon doré, refuse de communiquer avec ses parents, qu’il méprise, et prend ses ordres des créatures merveilleuses qui le visitent — à commencer par une météorite tombée sur son bureau. Mais la mission qui lui est confiée vient-elle des dieux, d’un des multiples masques gigognes de ces dieux, d’un démon, ou de son imagination nourrie de vaines lectures ? Le doute s’installera progressivement en lui, à force de revivre, avec un léger décalage, les mêmes aventures dans un monde si subtilement semblable au sien et différent à chaque fois.
Car sa mission est capitale : il doit délivrer les dieux des mauvais génies qui les infectent et qui sont responsables de la dégradation du monde. Soit. Mais que dire, lorsque le premier dieu à délivrer est son propre père, qu’il continue à mépriser, et que le génie qui l’infeste est Ti-Phang en personne ? Délivrer le monde, c’est d’abord se délivrer soi-même. Se délivrer des apparences, de ses identités successives et tout aussi fallacieuses, mourir de son corps, de son âme, de son esprit. Se délivrer de tous les personnages de ses lectures, qui l’encombrent et qu’il est contraint d’incarner pour s’en défaire. C’est rejoindre ce vide central autour duquel s’organisent les fils du labyrinthe.
C’est autour de ce vide que se construit le roman, qui, d’initiatique, prend un aspect mystique. Le vide qui n’est pas le néant est ce point énergétique d’une densité extrême où l’on échappe aux formes, donc aux apparences. Le seul point où l’être peut se passer de l’avoir. Mais peut-on y arriver en conservant la conscience constitutive de l’être ? La voie qui y mène, celle du Tao, est comme la lame d’un couteau : on ne peut la saisir sans se couper, et si l’on veut couper, il faut saisir le couteau par le manche. « On ne peut saisir ce qui sépare sans être aussitôt séparé de ce qu’on saisit ».
C’est dans cette leçon que réside l’originalité du roman, qui dépasse les aventures initiatiques familières aux lecteurs de Frédérick Tristan, qui les assume, semble s’y complaire, et les renvoie négligemment à leur vanité et à leur ultime contradiction : tous les acquis de l’initiation ne sont que le manche du couteau dont la lame ne pourra jamais être saisie.
Frédérick TRISTAN, Don juan, le révolé, éd. Ecriture, 2009.
Depuis près de quatre siècles, don Juan hante la littérature mondiale. Si on l’ignorait, un coup d’œil sur la bibliographie rassemblée par Frédérick Tristan suffirait à nous en convaincre. Mais nous ne savions pas à quel point. Le mythe qui se met en place à la fin de la Renaissance est d’abord celui de l’homme moderne, et derrière les masques de Faust, de Hamlet, de don Quichotte, ce sont des avatars de don Juan qui se cachent, ou plutôt, des personnages qui ont dû répondre aux mêmes questions, et souvent dans le même sens, dans des contextes différents. À ce titre, Laclos, Sade ou Nietzsche sont à leur manière héritiers de don Juan. Et chacun d’entre nous, bien entendu.
À commencer par Frédérick Tristan. Le familier de son œuvre y tissera aisément un réseau donjuanesque dont il trouvera de discrets échos dans cet essai. Il n’est pas seulement anecdotique que la soubrette amoureuse s’appelle Zerline, dans La femme écarlate, roman contre-initiatique de la révolte. Ni que dans sa volonté d’être Dieu, don Juan devienne « le dieu des mouches », ou un « homme sans nom » — deux titres de ses romans : Alexandre, dans le premier, est un passionné de Dieu dont l’acte de foi est le blasphème ; le second réunit une série d’ « insensés » qui, portant la lucidité comme une lampe, ont incendié le monde qu’ils voulaient éclairer. Deux démarches que l’auteur analyse dans cet essai.
Le moindre détail nous ramène à l’ensemble de son œuvre. La façon dont la légende se déplace en Europe, « en quinconce », comme le cavalier du jeu d’échec, est celle que le romancier prête à ses personnages (Les égarés), voire à sa démarche de créateur (Le retournement du gant II). Le « bègue supérieur » qu’est don Juan renvoie (entre autres !) à Balthasar Kober, l’étudiant bègue dont les « tribulations héroïques » forment un conte initiatique. Ces quelques clins d’œil suffisent à attirer notre attention : il ne s’agit pas ici d’un essai supplémentaire sur un mythe ressassé, mais une véritable histoire de l’homme moderne, et un fil d’Ariane discrètement donné par l’auteur pour évoluer dans le labyrinthe de ses livres. Livre sur le personnage de don Juan, sur l’homme moderne et sur Frédérick Tristan : c’est dans ces trois dimensions que nous allons aborder cet essai dense, encyclopédique, et incroyablement lumineux.
Lumineuse, cette analyse préalable du contexte dans lequel apparaît le mythe. À la fin du moyen âge, l’Occident ressent encore une double rupture géographique : dans le sens vertical, du point de vue politique (le royaume et l’empire) ; dans le sens horizontal du point du vue culturel (les pays germaniques et latins). Faust, comme Hamlet, héros du nord, apparaît en Allemagne et en Angleterre, pays protestants ; don Juan, comme don Quichotte, héros du sud, en Italie et en Espagne, pays catholiques. Nord et sud se rejoindront dans le Don Juan de l’Autrichien Mozart sur un livret de l’Italien da Ponte. Il n’est pas étonnant que Frédérick Tristan y fasse, à juste titre, le nœud de cette évolution de la pensée occidentale.
Il ne suffit pas de le dire. Encore faut-il en tirer toutes les conséquences. Et Frédérick Tristan, Ardennais fasciné par Venise, à laquelle il a consacré plusieurs livres, est bien placé pour nous l’expliquer : dans deux de ses romans d’allure initiatique, de jeunes héros allemands achèvent leur apprentissage à Venise. Balthazar Kober et Friedrich (L’atelier des rêves perdus) peuvent sembler loin de don Juan. Mais eux aussi, à l’aube des temps modernes, traversent une Europe ravagée par les guerres, portés par les mêmes espoirs et les mêmes questions : quelle est la place de l’homme dans un monde qui a renoncé à mettre Dieu au cœur de sa réflexion et la terre au centre de l’univers ? Les réponses germanique et latine ont d’étranges résonances.
Tuer le Père
Faust et don Juan sont les deux aspects de la révolte contre Dieu. En cela, et c’est la première ligne directrice de cet essai, l’enjeu de don Juan est l’éclosion et la survie du monde moderne. L’ordre paternaliste, celui du moyen âge chrétien, arrête l’évolution : aucune pensée, aucun progrès ne sont possibles dans la certitude. « Pour que le monde continue, il faut que le fils s’oppose au père et lui ravisse l’esprit (symbolisé généralement par sa fille). » Il faut nier la certitude, y compris celle de Dieu, pour rendre « à l’aventure humaine toute sa dramatique valeur d’incertitude. La pensée humaine, de nos jours, est à ce prix. » Il faut se révolter, au prix de la damnation, car don Juan reste un croyant, pour que le temps puisse progresser en libérant l’homme d’une vérité immuable. « Don Juan, dans un univers de clepsydres, d’horloges, de sabliers et de tables solaires, choisit le temps contre l’éternité. » Voilà pourquoi son avatar moliéresque engage le pauvre à jurer : dans cette foi naïve et inébranlable, il a reconnu l’ennemi, « celui qui croit en l’affirmation des idées et des choses ».
Don Juan, révolte nécessaire contre un ordre immuable ; révolte tragique, car il croit profondément à ce qu’il conteste. Autre visage de Lucifer, il ouvre le monde à la multitude des possibles et donne à l’homme la connaissance de toute chose par la science et la raison, dégagées du dogme. Et comme le tentateur de la Genèse, il promet à l’homme d’être comme Dieu, ou supérieur à Dieu.
Cette réflexion se situe donc dans la lignée de L’homme révolté de Camus, dont il reprend les grandes thématiques (révolte, création, réalité...) et les principaux exemples (Sade, Byron, Nietzsche...), mais en y ajoutant les racines médiévales et classiques que ce dernier avait négligées. Avant la « révolte métaphysique » analysée par Camus, Tristan voit en don Juan une révolte théologique, qui accepte la damnation au nom de son refus. Il rejoint, en évoquant Sade, la lignée des grands révoltés de Camus, mais y voit autant d’avatars de don Juan, passé à la révolte métaphysique. Viendra enfin la révolte intellectuelle, lorsque, après Nietzsche, le donjuanisme occidental a pris en compte la mort de Dieu. Ne pouvant plus s’en prendre à lui, le Don Juan moderne s’en prend à la condition d’être un homme, qu’il a l’ambition de changer.
Cette analyse éclaire bien des contradictions du personnage, que l’on attribue trop facilement aux auteurs qui s’en sont emparé. Un mythe résiste aux adaptations des hommes : en grattant l’anecdote, Tristan en extrait l’essence. Le don Juan longtemps cru historique, don Miguel de Mañara, a ainsi connu une retentissante conversion jusqu’à la béatification comme fondateur d’ordre. Quel rapport avec le célèbre damné ? Ce sont les deux réciproques d’un même théorème, nous explique Tristan : le personnage littéraire refuse la Grâce que le second accepte. Mais tous deux répondent aux subtiles théories sur la Grâce dont s’est entiché le XVIIe siècle. Le don Juan homosexuel imaginé par Marañón n’est pas une boutade anodine : comme l’homme à femmes de la tradition, il s’est mis au-dessus des lois, et c’est la révolte qui caractérise don Juan, non la séduction. Sade appartient sans surprise à sa lignée, celle du crime le plus abominable qui soit. À ce niveau, don Juan incarne le combat terrifiant qui se déroule au noyau de l’univers, « c’est-à-dire dans les principes vivants de l’univers et dans la conscience de certains hommes ».
Combat voué à l’échec, et il le sait : comme pour Adam au paradis terrestre, la liberté ne s’achète qu’au prix de la mort. Tuer Dieu pour être Dieu, c’est accepter de mourir comme Dieu. C’est renoncer à l’éternité pour entrer dans le temps. C’est ce que vivent, depuis toujours, les personnages de Frédérick Tristan. On pense au Dieu des mouches, bien sûr, mais aussi au serviteur qui a pris la place de son maître, dans Dernières nouvelles de madame Berthe : le départ du Père symbolique laisse le fils désemparé, condamné au silence, à l’immobilité et à la mort. Le drame du père et du fils est au centre de son œuvre.
Historiquement, l’époque moderne a accumulé les révoltes contre le père : contre le pape, avec la réforme ; contre le roi, à la révolution contre Dieu, avec le scientisme... Ce contexte extérieur a rencontré un destin particulier : Tirso de Molina est l’enfant naturel d’un grand d’Espagne, don Juan Tenez y Giron, duc d’Osuna. Son personnage porte le prénom paternel (Juan), mais prend le nom d’un autre grand d’Espagne, Tenorio. C’est le Père, dans sa dimension familiale et sociale, qui est ici visé. Et cette révolte a son pendant dans les sociétés initiatiques qui commencent à pulluler à la même époque : « Il faut que le fils tue le père, que l’initié sacrifie l’initiateur s’il eut assumer son existence en assouvissant son sentiment de liberté. »
Enfanter la Mère
Mais pourquoi, pour étudier la révolte de l’homme moderne contre Dieu, Frédérick Tristan a-t-il choisi le mythe de don Juan, que l’on voit plutôt comme un séducteur, plutôt que celui de Faust ? Précisément, et c’est la deuxième ligne directrice, parce que le héros latin, à la différence du germanique, ajoute à la révolte contre Dieu la transgression des relations traditionnelles avec les femmes. Il joint donc la rébellion contre le Père (le Commandeur, et derrière lui, Dieu) à l’affrontement avec la Mère (les femmes, et derrière elles, la Nature). Don Juan est celui qui s’oppose au monde selon deux ordres différents : la Nature et la société. Ainsi, les deux facettes du personnage, que l’on met rarement en relation, celui qui séduit les femmes et celui qui défie Dieu, se rejoignent-elles dans une même révolte. « Dans le temps que l’on s’emploie à renverser le père (le roi et Dieu), on va tenter de débaucher la mère (la nature et la société). »
Ici encore, le lecteur de Frédérick Tristan se souvient de l’imposante stature de la Femme-Mère-Amante, de La Divine à Madame Berthe, autant d’avatars de la Gargante, cette image de la Nature déchue, « dénaturée » après la chute d’Adam. C’est à celles-ci que renvoie cet essai en évoquant « la vieille complice du flux et du reflux, de ces choses trop vagues, tellement vraies, que sont les apparences du temps ». Mais plus profondément, « à travers la femme, c’est l’idée du réel que l’on provoque. » Et pour un romancier, le rapport entre la réalité et le réel est une réflexion indispensable.
La naissance du mythe dans l’Espagne baroque s’inscrit dans cette réflexion. Une société qui cache la dissolution de ses mœurs derrière une religiosité rigide est un milieu propice à l’éclosion du burlador, qui plus que tout autre sait jouer du masque. Certes, le masque est hypocrite puisqu’il dérobe le réel. Mais il ne le cache pas : il le travestit sous l’outrance pour nous le rendre plus sensible, donc plus vrai. Le masque, que le baroque a érigé en art, est une transposition du réel en réalité par l’outrance des situations et des personnages. C’est une fiction qui dénonce cette autre fiction qu’est l’hypocrisie sociale. Don Juan n’est pas le trompeur : c’est celui qui, par l’excès de sa conduite, met à nu la petite tromperie quotidienne.
Or, parmi ces hypocrisies de la réalité, le mythe de don Juan pointe du doigt le maintien artificiel d’une idéologie courtoise dans le monde classique. Le rêve de la femme sublimée s’arrête avec lui. « Libéré des mythes féminins de la nature, de l’amour et de la mort, l’homme allait pouvoir, à sa suite et à travers ses métamorphoses, procéder de lui-même et de lui seul, c’est-à-dire, en grande partie, reprendre à son compte les idées de nature, d’amour et de mort pour les transformer en concepts. » Après la mort du père, l’autre grand thème véhiculé par le mythe est la mise au monde de la mère. Ces deux grandes inversions sont les conditions nécessaires à l’enfantement du monde moderne.
Car la révolte est la même. Père et mère, Dieu et Nature, même s’ils semblent opposés, sont indissociables. Il n’est pas question de jouer l’un contre l’autre, ou de se perdre dans le jeu des masques qu’affectionne le baroque. Derrière le masque don Juan ne se cache pas un personnage, mais « l’homme sans nom ». C’est le masque suprême. Il a pris conscience du vide béant qu’il découvre en lui-même et dans le monde.
C’est en cela que sa révolte ouvre un autre âge de l’humanité. Don Juan remplace le Père par une idée de Père, la Mère par une idée de Mère. C’est le triomphe du rationalisme, la rupture avec la « communion amoureuse et quasi mystique » avec la Nature, la Femme, Dieu. Pour refuser la leçon des tripes, don Juan enfante avec son cerveau — « cette autre tripe ». Le réel est remplacé par l’abstraction, par une réalité d’ordre intellectuel. « Le mental est plus puissant que le réel, parce que le mental existe, tandis que le réel n’existe pas » : telle est la découverte fondatrice, qui chasse l’homme du paradis perdu de la communion cosmique. Dans les romans de Frédérick Tristan, elle correspond à l’exclusion, ou l’évasion du grand hôtel dans lequel l’enfance a résumé le monde. C’est l’entrée dans le temps, dans la vie qui s’écoule et qui tend vers la mort. Certes, on n’échappe à l’imposture du monde que pour tomber dans une autre imposture, mais avec la lucidité désespérée de la révolte.
L’âge du Fils
Cette révolte conjointe contre les deux ordres du Père et de la Mère est la condition d’émergence de l’art. L’art est lucidité suprême et quête d’une suspension du temps dont on a pris conscience. Grâce à lui, nous passons « du quotidien obsédant ou veule à l’abstraction d’un temps qui se veut suspendu », même s’il se nourrit de ce quotidien, de nos pensées. C’est dans ce jeu constant entre la réalité et sa représentation, dont chacun se nourrit de l’autre, que nous reformulons nos questions, ce qui les rend acceptables. Les créations artistiques gardent la mort à distance, et en particulier celle qui s’insinue dans le quotidien, « l’ennui, ce truchement de la mort au cœur de la vie ».
La peur de la mort est désormais au cœur du Fils, car il a tué le Dieu qui le rassure sur l’au-delà. Il ne lui reste qu’à « devenir ce qu’il souhaite être — et qu’il nomme Dieu », avec cette conscience, désormais, que même les dieux sont mortels et que la déification ne le délivrera pas de son angoisse primordiale. Tout le long de cet essai, qui descend avec le mythe le cours des siècles, nous suivons les tentatives les plus folles, les plus paradoxales, mais peut-être les plus belles pour répondre à cette nouvelle question.
En perdant la voie de l’obéissance (celle du moyen âge, avec le mythe de Perceval), l’homme moderne ne peut choisir que la démesure. Celle du mystique qui cherche l’union immédiate n’est pas fondamentalement différente de celle de don Juan, qui passe par le crime « le plus haut possible » pour se croire Dieu. Cela pose en principe la liberté de la créature, mais empêche le bonheur (le sale bonheur), et la souffrance devient le signe de la grandeur. Dieu reste seul comme le Commandeur à l’intérieur du labyrinthe. Don Juan s’est enfui, mais ne nous a pas livré le mot de passe qui nous permettrait de sortir à notre tour. Alors les labyrinthes se multiplient, s’emboîtent les uns dans les autres au gré de l’imagination. N’est-ce pas l’image de l’homme, ce labyrinthe de viscères pris dans le labyrinthe du monde ? Il se croit libre, parce qu’il a ouvert tous les possibles. Mais que vaut cette liberté sans le fil d’Ariane qui retrouve le sens dans l’éclatement des significations ? Tel don Juan mangeant des excréments, des larves et des serpents accoudé sur une tombe, l’homme moderne se penche sur le grouillement infâme et infamant qu’il recèle en lui-même. « Demain, ce sera Freud. On veut savoir ce qu’est cet abîme. » Et cela finira avec l’autofiction.
L’histoire de monde ainsi redessinée donne lieu à des évocations puissantes : celle de la Venise du XVIIIe siècle, royaume de l’imposture ; de Blake et Milton, engendrant leur propre mythologie en puisant aux sources sacrées ; celle de Nietzsche, « totalement enfermé entre ses épaules », qui recommence pour lui seul l’aventure occidentale. Autant de don Juan dont le « prodigieux onanisme intellectuel » débouche sur le totalitarisme solitaire de l’Occident moderne. Il ne reste plus à don Juan qu’à dénaturer (pour le purifier ? le détruire ?) le langage. « Il est vraisemblable, en effet, que le premier des don Juan est le langage et sa propension à se dénaturer lui-même afin de tenter d’explorer l’indicible. »
Reste la troisième voie, celle de l’initié, qui émerge à la même époque. Celui qui retourne à la tradition perdue, par une approche progressive, au noyau originel, qui rentre dans le labyrinthe pour le purifier, au lieu de se perdre dans celui qu’il s’est créé en dehors de lui-même. Ici encore, rien de contradictoire. La mère que l’homme moderne enfante est l’univers dans sa totalité ; ce n’est plus la Gargante originelle, c’est la Mère des Galopins qui initie Balthasar Kober. Explorer tous les possibles, c’est aussi revenir aux sources, puisque la source est partout. L’intérieur et l’extérieur se correspondent dans une ordonnance sacrée. Accepter que l’ordre, non pas celui du Commandeur, mais un fil d’Ariane à travers le dédale du monde, soit plus sacré que la liberté de tous les possibles, telle est la voie qui ne renonce pas à une « saine révolte de l’esprit », mais qui lui rend le Sens.
Jean Claude Bologne
(Inédit)
Frédérick Tristan, Enquête sur l’impossible, Fayard, 2009.
Dans la Judée du Ier siècle, entre la mort du Christ et l’incendie de Jérusalem, un juif hellénisé d’Alexandrie, élève du philosophe Philon et citoyen romain, reçoit mission de mener une enquête sur les groupes séditieux qui menaceraient la paix romaine. Il se retrouve bientôt mêlé à ceux que, par dédain, on appelle « christiani », disciples d’un crucifié qu’ils présentent comme le fils de Dieu. Nourri de la tradition juive, de la pensée grecque, de la culture romaine, l’envoyé de Rome a toutes les références pour comprendre ces événements auxquels il n’a pas assisté, mais qui lui parviennent, déformés par les témoins, enjolivés par une tradition en train de naître. Il a aussi la chance de passer, pour s’exprimer, par la plume de Frédérick Tristan, qui met à son service un talent éprouvé de romancier et une connaissance approfondie du christianisme primitif.
Apollonios n’a pas connu le Christ : il n’ a sa disposition qu’une matière déjà retravaillé. Le choix du romancier est d’ajouter une distanciation linguistique à cette distance entre le sujet et le témoin de ses témoins. En Judée, à l’époque, on entend au moins parler hébreu, araméen, grec et latin, et les personnages portent les noms de leur origine. Ieshoua est le Messiah pour les uns, le Christos pour les autres ; Pontius Pilatus se dénonce tout de suite comme romain et Lukas comme grec. Cela demande une petite gymnastique intellectuelle, aidée par un lexique pour les noms les plus connus, mais il faut malgré tout une certaine culture biblique pour identifier, par exemple, l’Égypte derrière Misraïm. Cette distance est cependant indispensable pour se démarquer, dans cette reconstitution intelligente, du pastiche des évangiles. Apollonios est témoin du récit, non de faits sur lesquels à aucun moment il ne prend parti.
L’enquête se déroule non sans humour, pour ceux qui connaissent la fin de l’histoire. Apollonios est persuadé que l’entreprise est vouée à l’échec. Comment un petit groupe peut-il lutter à la fois contre l’armée romaine, contre le Sanhédrin, et contre tous les partis qui déchirent les Hébreux ? Mais il est de plus en plus fasciné par celui dont la vie « fut la signature de l’ineffable ». Il incite les compagnons qui ont connu le Christ à transcrire leurs souvenirs, et écoute les nouveaux convertis interpréter les sermons selon leur culture. Ainsi se constitue sous nos yeux une tradition qui n’a encore rien de canonique.
Quelques fidèles, selon leur tempérament, reconstituent l’histoire de Ieshoua. Certains y ajoutent des éléments populaires, des miracles qui circulent dans les imaginations orientales. D’autres, pour prêcher dans les synagogues, y superposent des références à l’Ancien Testament. Certains préfèrent y intégrer les mythes gréco-romains ou des concepts philosophiques qui séduiront les païens. Ainsi la vie de Ieshoua se transforme-t-elle « en une légende populaire non exempte de scories mythiques appartenant au vieux fond méditerranéen. » Il faut une parole pour les humbles et une autre pour les instruits, une pour les Juifs et une pour les Gentils. Ce ne sont pas des versions différentes, mais, pour les synoptiques, une écriture à trois voix. Apollonios y joindra aussi la sienne, dans une fin surprenante qui constitue sans aucun doute la meilleure idée du roman.
Mais cette histoire, en train de devenir officielle, n’est pas l’essentiel de ce roman, qui ne se veut pas un essai sur l’origine du christianisme, même si le lecteur en apprendra beaucoup sur une période aussi touffue qu’obscure. L’histoire est à l’image de la conscience, et les personnages vivent dans ses tribulations leurs soubresauts intérieurs. Les Romains occupant la Judée sont « la faute qui obstruait la liberté spirituelle ». Chaque Judéen est « un Israël encombré par une Rome intérieure ». Le combat à mener est non seulement dans le monde, mais plus encore en soi-même. L’enquête officielle devient insensiblement une quête initiatique. Le message de Pierre passe peu à peu à celui de Jean, tandis que Paul, ce « tenace vibrion » pour qui l’auteur ne semble pas avoir une sympathie démesurée, ne parvient à voir que de l’extérieur, par l’intelligence, ce qui n’a de sens que vécu de l’intérieur. « Que ne suis-je inspiré ! J’ai trop lu, trop étudié avec ma tête. Maintenant, me voilà démuni devant un tombeau vide ! » Éternelle malédiction de l’intellectuel, qui rend touchant, par moment, celui qui pourrait passer pour un opportuniste. Paul est aussi celui qui a trahi la simple appréhension des choses par l'horrible "tripe" du cerveau, pour reprendre une image chère à l'auteur.
Petit à petit, on est ainsi amené à une conception plus philosophique, ésotérique, puis mystique de la religion en train de naître. Avec Jean, nous comprenons que le sang de la croix en tombant sur le sol a libéré la terre de l’empreinte du serpent, parce qu’il contient le kabod, la lumière incréée d’avant les jours. Et à travers Philon, qui n’a pas connu le Christ, se révèle peut-être son plus subtil message : puisque le Dieu juif est à jamais inaccessible aux humains, c’est l’Oint caché en chacun de nous qu’il faut révéler. N’est-ce pas ce que rend sensible l’incarnation ? Au-delà de toute croyance et de toute interrogation sur sa réalité historique, le Christ, en vingt ans, est devenu un personnage aux multiples facettes dans une fiction en perpétuel réinterprétation, car, peut-on déduire des étonnantes dernières pages, c’est à chacun de nous d’en rédiger la fin. |